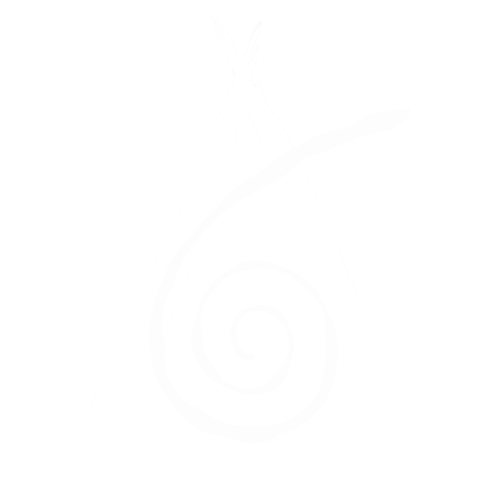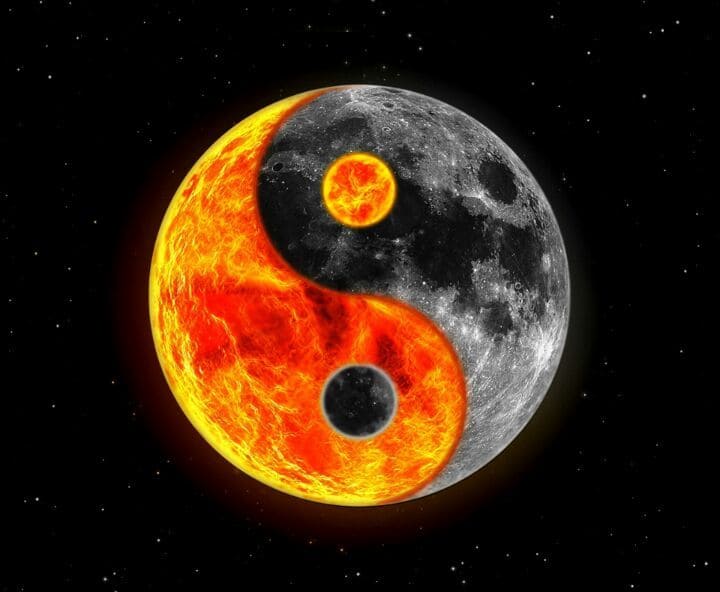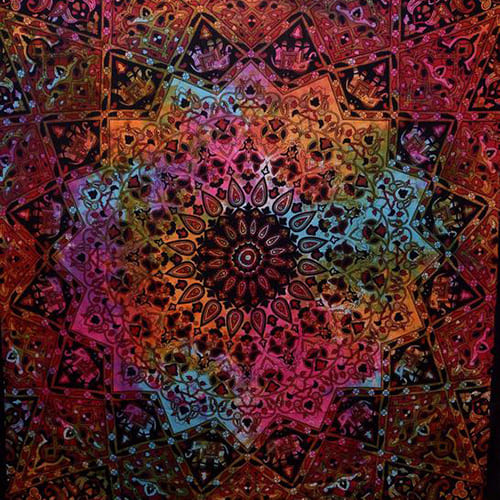Parentalité aujourd’hui : À la croisée des héritages, des défis et des transformations intérieures
Un monde en mutation, des repères brouillés
Devenir parent aujourd’hui ne va plus de soi. Dans un monde en perpétuelle transformation – individualisation des liens, éclatement des modèles familiaux, hyperconnexion, précarité, pressions sociales – la parentalité se complexifie. Loin de l’évidence naturelle ou des rôles figés, être mère ou père interroge désormais les fondements même de l’être, de l’histoire et de la psyché.
Les professionnels de l’enfance, confrontés à la souffrance des enfants et à la désorientation des adultes, alertent : il ne s’agit plus seulement de transmettre des savoirs éducatifs ou de juger les compétences parentales, mais de repenser en profondeur ce que signifie porter et soutenir la vie psychique d’un enfant, en s’ancrant dans les fonctions fondamentales du maternage et de la paternité.
La fonction maternelle : contenir, relier, incarner la sécurité
La fonction maternelle ne se réduit pas au biologique ou au rôle de la « mère ». Elle est un principe archétypal et structurant qui incarne la capacité de contenir, d’accueillir, de créer du lien. Selon Winnicott, c’est par le « holding », ce geste qui soutient et enveloppe, que le bébé accède à une sécurité intérieure suffisante pour commencer à exister psychiquement.
Mais que devient cette fonction dans un monde où les mères sont parfois elles-mêmes carencées, isolées, traversées de leurs propres blessures non digérées ? Que devient ce contenant lorsque l’histoire infantile des parents infiltre leur présent, au risque de projeter sur l’enfant des attentes de réparation, de fusion ou de pouvoir ?
L’enfant-fusion, l’enfant-réparateur, l’enfant persécuteur sont autant de figures révélatrices de ce que l’enfant peut porter pour ses parents. Dès lors, accompagner la parentalité, c’est aussi offrir un espace pour penser les empreintes maternelles, souvent inconscientes, pour aider la mère à devenir non pas une fonction fusionnelle, mais une présence vivante, différenciée, consciente.
La fonction paternelle : séparer, structurer, transmettre
De façon complémentaire, la fonction paternelle vient introduire la différence, la séparation, l’accès à la loi symbolique. Ce père-là n’est pas tant une figure autoritaire qu’une présence structurante, qui permet à l’enfant de sortir du monde clos de la dyade mère-enfant pour se risquer au monde, à la parole, au désir.
Mais qu’advient-il de cette fonction lorsque le père est absent, effacé, idéalisé ou violent ? Lorsque les représentations sociales brouillent son rôle, entre la figure du père copain et celle du père rigide ? La fragilité des pères contemporains, souvent mal préparés, révèle l’importance de réhabiliter une paternité symbolique, non pas pour « corriger » la mère, mais pour co-construire un espace d’altérité et de croissance pour l’enfant.
La transmission : entre héritages et répétitions
Dans toute parentalité, se rejoue le théâtre des origines. Devenir mère ou père, c’est nécessairement convoquer les traces laissées par nos propres parents : leurs silences, leurs gestes, leurs absences, leurs excès. C’est réactiver ce que l’enfant que nous avons été n’a pas pu dire ou recevoir.
La transmission intergénérationnelle n’est pas linéaire. Elle est souvent infiltrée de non-dits, de loyautés invisibles, de douleurs figées, qui s’invitent dans la relation à l’enfant. L’accompagnement de la parentalité ne peut faire l’économie d’un travail sur l’histoire singulière de chaque parent, ni sur les représentations qu’ils se font de l’enfant, de sa place et de sa fonction dans leur vie.
La mère en soi, le père en soi : vers une parentalité consciente
Il y a, au-delà des rôles sociaux ou biologiques, des forces archétypiques à intégrer en soi. La Mère en soi – contenante, bienveillante, puissante et parfois dévorante. Le Père en soi – séparateur, bâtisseur, initiateur et parfois castrateur. Réconcilier ces polarités intérieures, c’est restaurer un socle intérieur solide pour l’adulte que nous devenons, pour l’enfant que nous accompagnons.
Ce travail d’individuation, inspiré des mythes (Déméter, Gaïa, Chronos, le Roi blessé…), des contes, des rêves, passe par une traversée des ombres et une relecture symbolique de nos fondements. Il s’agit de devenir la mère et le père de soi-même, de créer une nouvelle matrice de sécurité intérieure et d’autorité douce, capable de contenir nos blessures, nos élans, et de transmettre, non pas un savoir, mais une présence habitée.
Pour l’enfant : être accueilli et orienté
L’enfant, pour se développer harmonieusement, a besoin d’une double présence :
- une mère suffisamment bonne pour le contenir, le relier, l’envelopper sans le confondre avec elle-même,
- un père suffisamment présent pour le séparer, le guider, lui ouvrir l’horizon de la loi et du désir.
Là où l’une tisse le lien, l’autre trace un axe. Là où l’une accueille, l’autre oriente. Et ensemble, dans leur complémentarité (qu’elle soit portée par deux figures ou par une seule personne intégrant les deux fonctions), ils permettent à l’enfant de devenir sujet de son histoire, libre de ses élans, ancré dans une base suffisamment stable pour affronter le monde.
Conclusion : Parentalité comme chemin initiatique
Parentalité et développement personnel/relationnel ne s’opposent pas. Bien au contraire. Accompagner un enfant demande de s’être soi-même traversé·e, d’avoir visité ses parts blessées, ses colères enfouies, ses élans de vie brimés. C’est un chemin initiatique, autant qu’un acte d’amour.
Aujourd’hui plus que jamais, accompagner la parentalité suppose une vision intégrative : psychique, symbolique, sociétale et spirituelle. C’est en tissant un dialogue entre nos histoires, nos ombres et nos potentiels, que nous pouvons restaurer ces fonctions fondamentales de la Mère et du Père – en soi, pour soi, et pour les générations à venir.